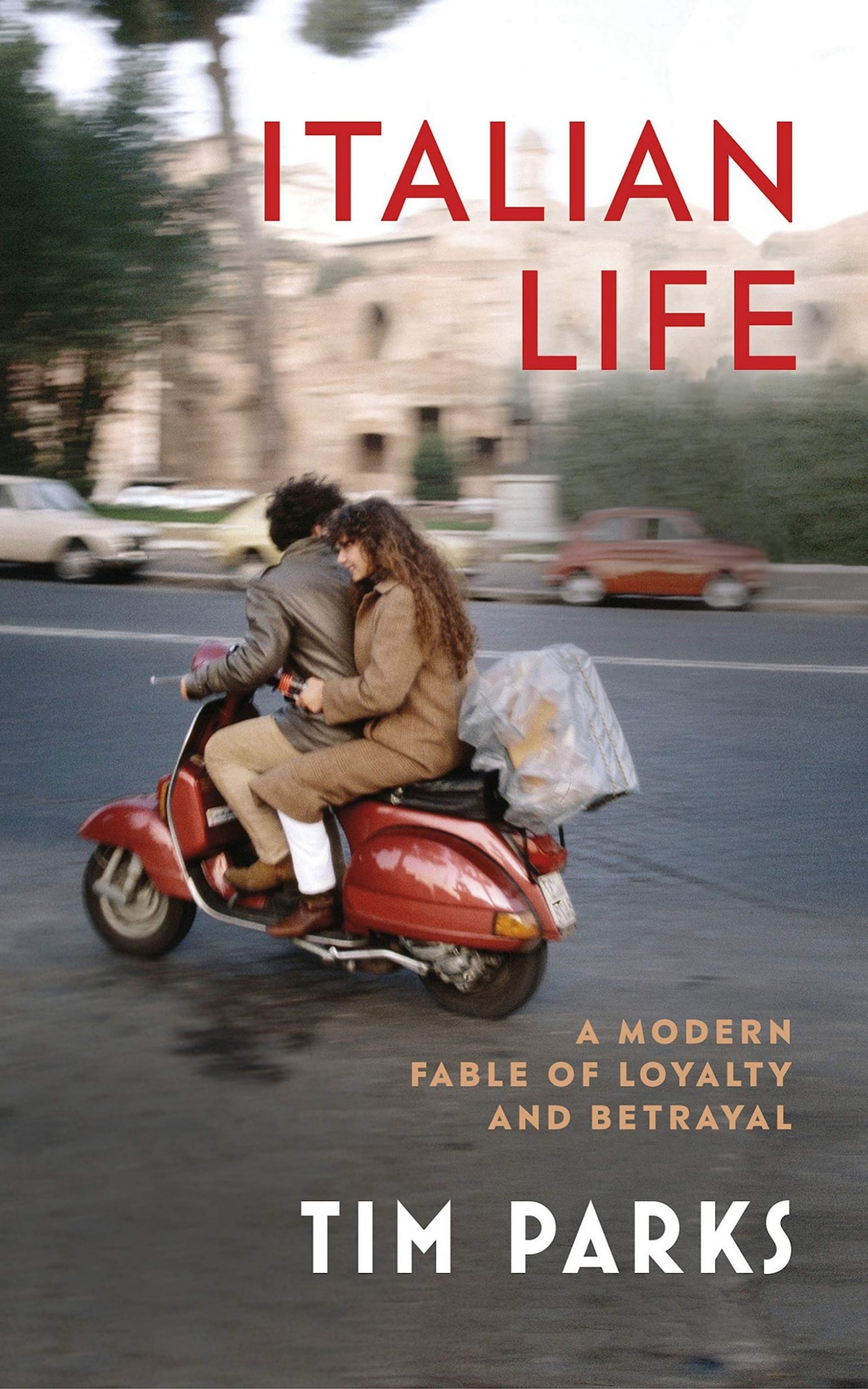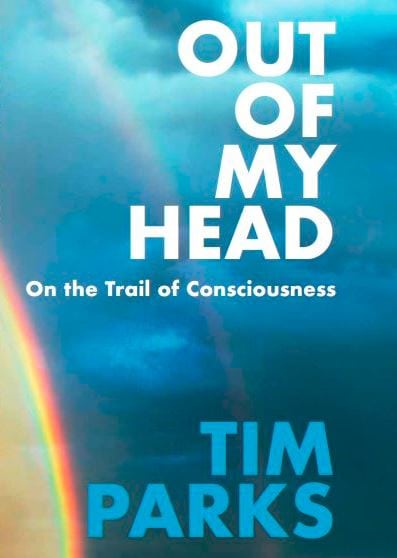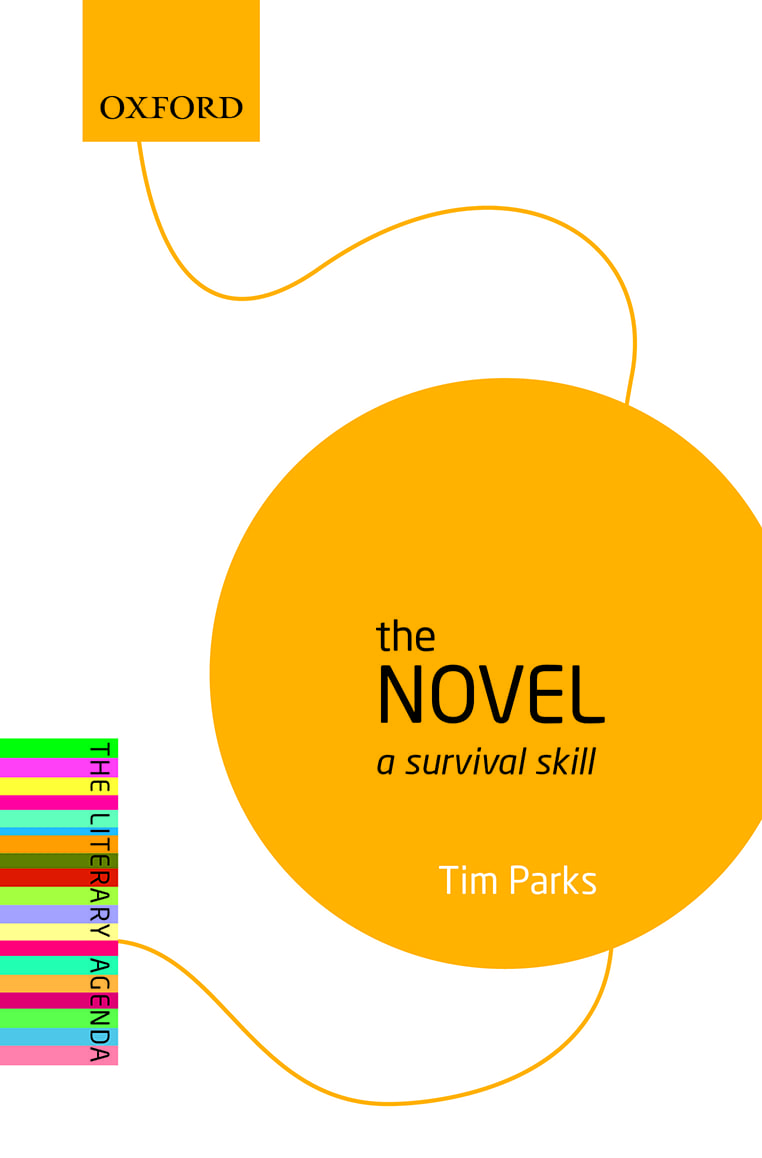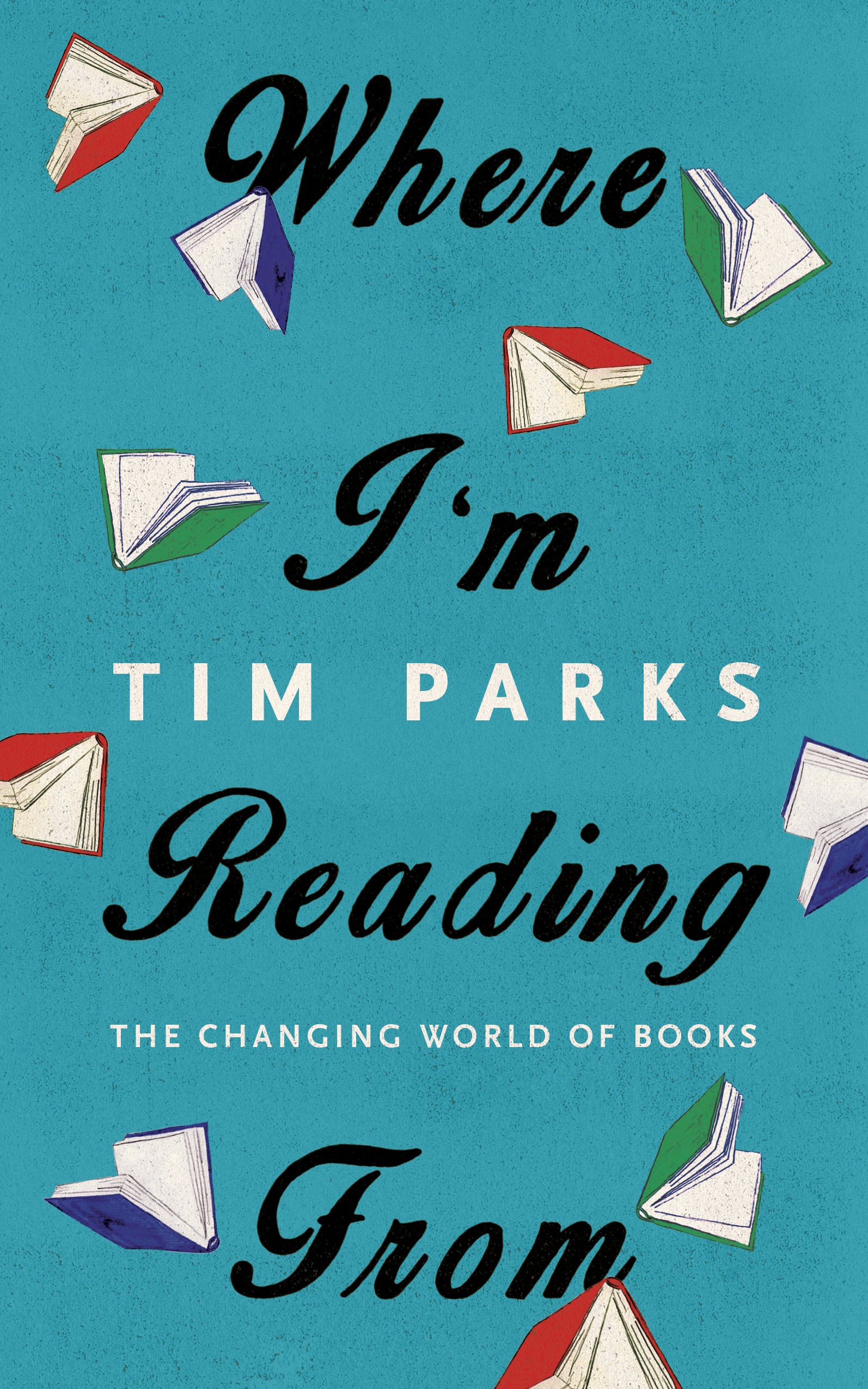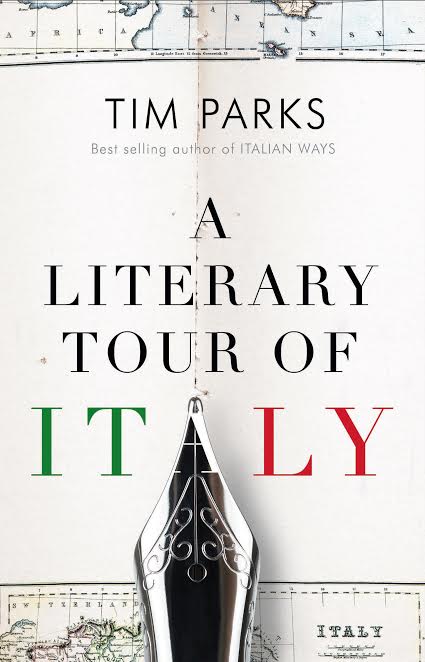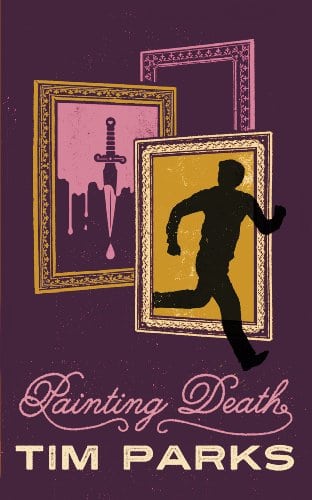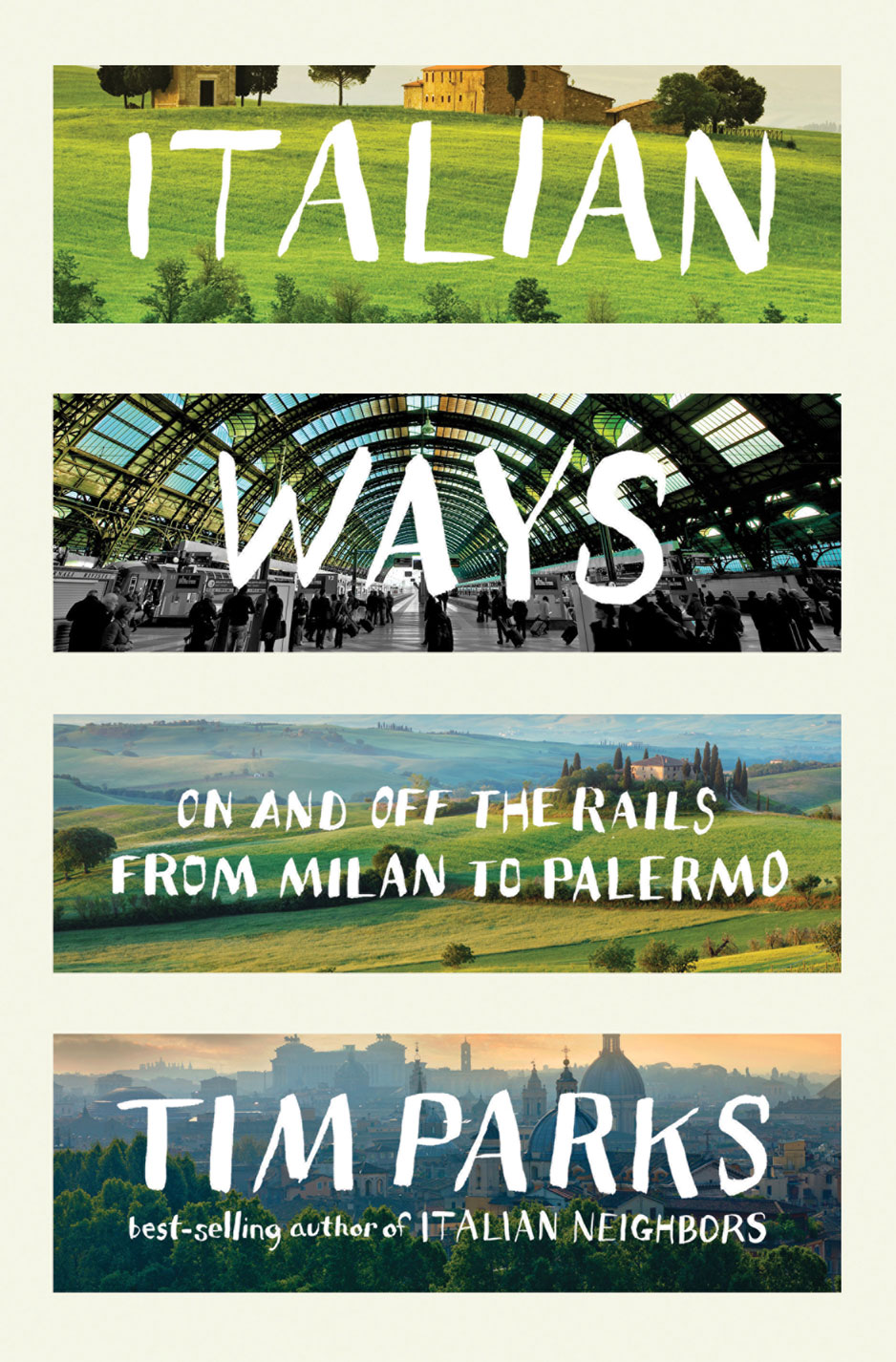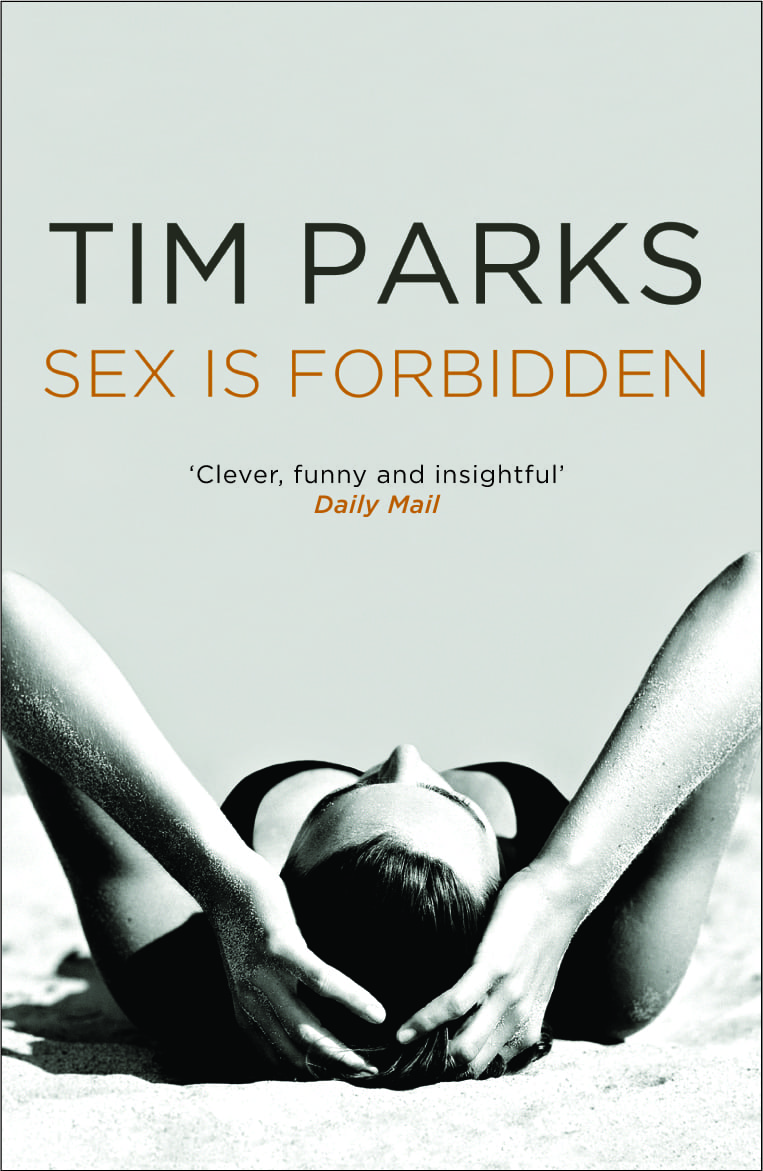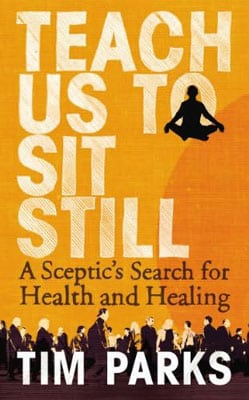Ce thème de l’incompréhension des cultures se démultiplie et s’intériorise dans Destin. Séjournant en Angleterre, Burton apprend que son fils, soigné dans une clinique psy- chiatrique italienne, vient de se suicider d’un coup de tournevis dans la poitrine. Accompagné de son épouse avec laquelle il est, depuis plusieurs mois déjà, aux limites de la rupture, il retourne en Italie pour récupérer le corps de son enfant – et avoir un entretien avec le sulfureux Andreotti. Le roman est entièrement construit sur un extraordinaire monologue intérieur où se conjuguent, s’entrelacent et se répondent les multiples figures de l’incompréhension, de la division, du hiatus, de la séparation, de la trahison et du conflit. Jusqu’au vertige, lequel est encore une manière de ruser avec la douleur.
On connaît le mot de Chamfort demandant à Dieu de lui épargner les douleurs physiques, lui-même se chargeant des douleurs morales. Destin prend le contre-pied romanesque de cette étroitesse suffisante de l’esprit. Ce qu’il dit n’est pas, pour l’essentiel, fondamentalement nouveau. Samuel Beckett et Thomas Bernhardt qu’il cite souvent ont fait voir avant lui que les progrès accomplis dans la guérison des corps s’accompagnaient d’une indifférence grandissante au soin des âmes. Et ce n’est pas la thérapie rusée inventée par le Dr Freud à l’intention des bourgeoises de Vienne qui changera quelque chose à ce sentiment d’abandon et de solitude. Burton, sa femme, son fils, Paola sa fille adoptive venue de Russie, se heurtent comme des mouches affolées aux parois d’une humanité dont on leur a dit qu’elle était sans limite et sans frontière et dont ils éprouvent à chaque instant, à l’intérieur d’eux-mêmes, les épaisses et blessantes murailles : » Nos vies sont parallèles à nos rêves, mais elles ne se re- joignent absolument jamais. »
Aux lecteurs qui pourraient prétendre que Destin appartient à l’univers de la fiction et que la traversée du deuil que décrit si préci- sément, si vivement le roman est un voyage imaginaire, une invention d’artiste, Tim Parks propose les chroniques d’Adultère et autres diversions. Ici, plus de roman. Celui qui parle est Timothy Parks, fils de pasteur anglican, professeur de littérature anglaise à l’université de Milan, supporter du médiocre club de football de Vérone, doté d’une belle-famille italienne et papiste, traducteur et admirateur des grands textes littéraires contemporains – et sans doute beaucoup moins de ceux qui les écrivent. Adultère, comme Destin, traite avec lucidité et compassion de cette créature incertaine qu’est l’homme; mais il s’agit cette fois de photographies prises sur le vif, dans le cours ordinaire des choses. Une sorte d’encyclopédie pascalienne de l’incompréhension de nous-mêmes dont les articles brillants et navrés auraient pour thèmes notre fondamentale, vitale et catastrophique infidélité : » Personne n’a compris aussi clairement que Platon que le monde est le lieu du changement et de la trahison. » Lesquels ne disparaissent que par la reddition et l’abandon, jamais par l’acquiescement ou par l’enthousiasme. Parks trouve d’émouvantes et amusantes histoires pour distiller allègrement cette sombre morale de la perplexité et de la scission entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Il y a longtemps que le roman anglais n’avait philosophé avec tant de vigueur, de couleur et de talent. Avec de temps en temps, dans le genre de la comédie cruelle, des scènes d’anthologie. Parks écrit des choses passionnantes sur la traduction et sur la manière dont » à travers nous la langue se parle à elle-même « .