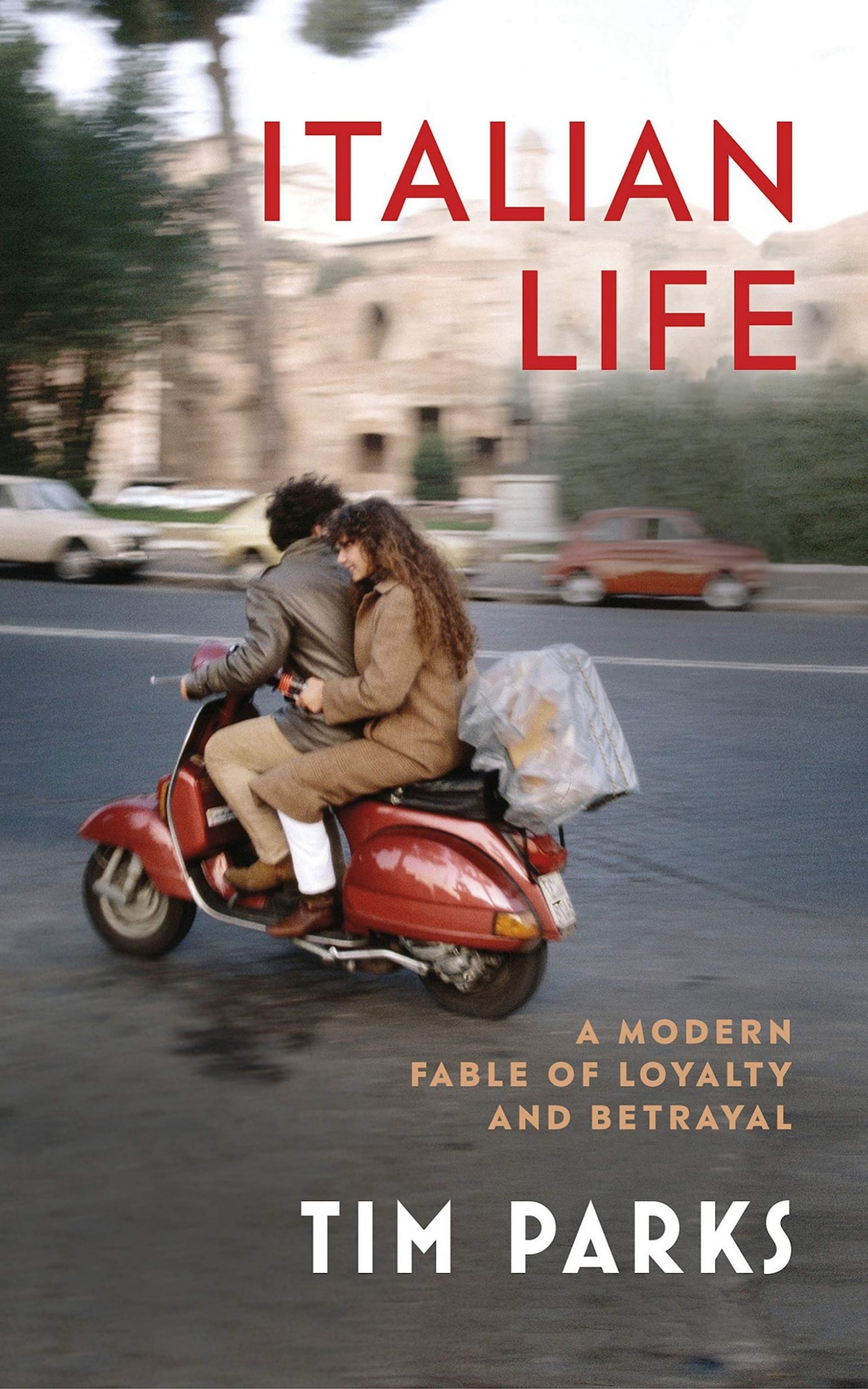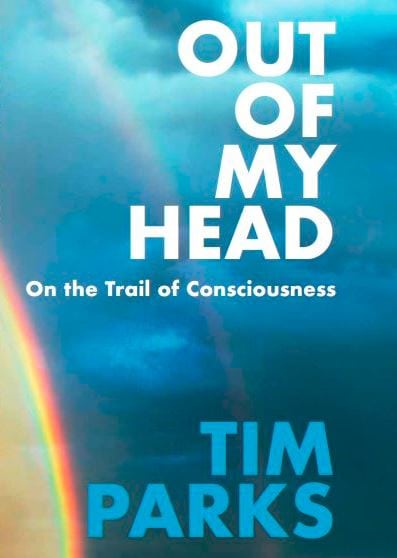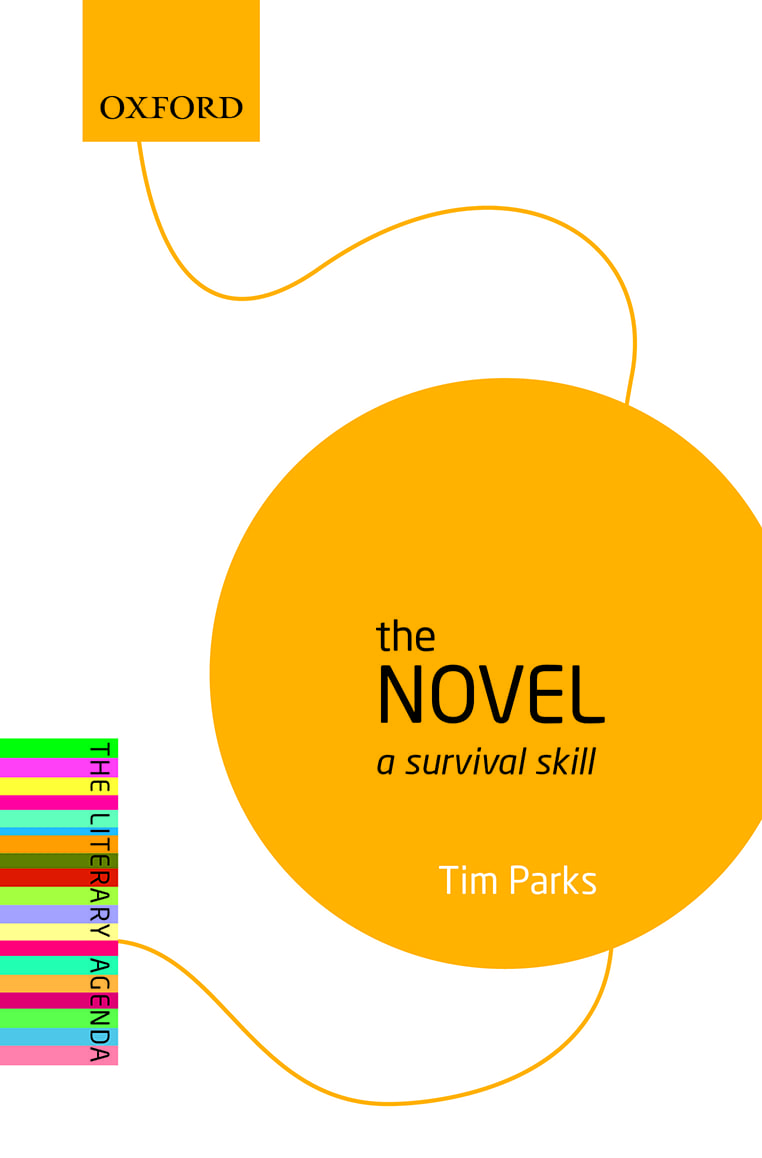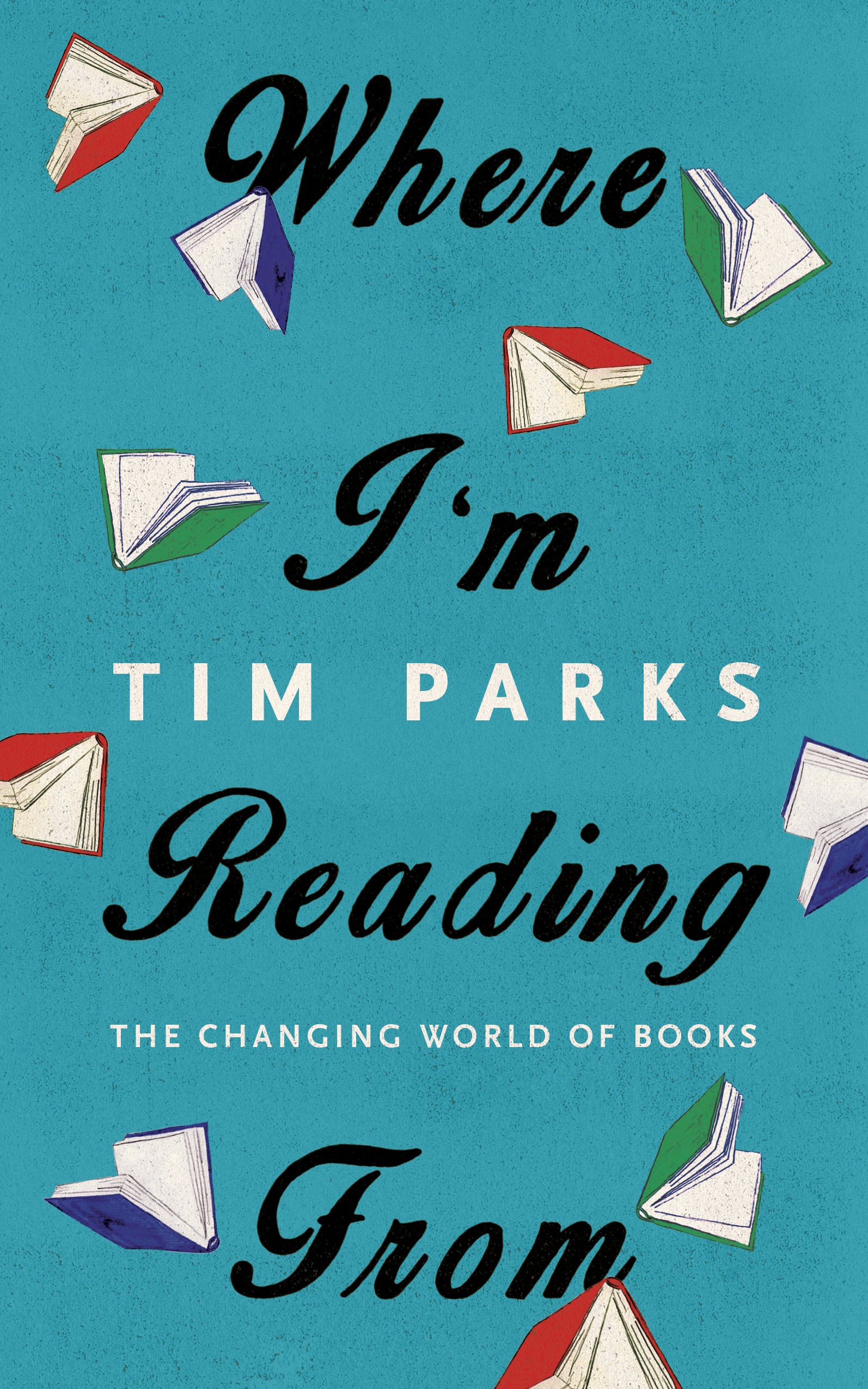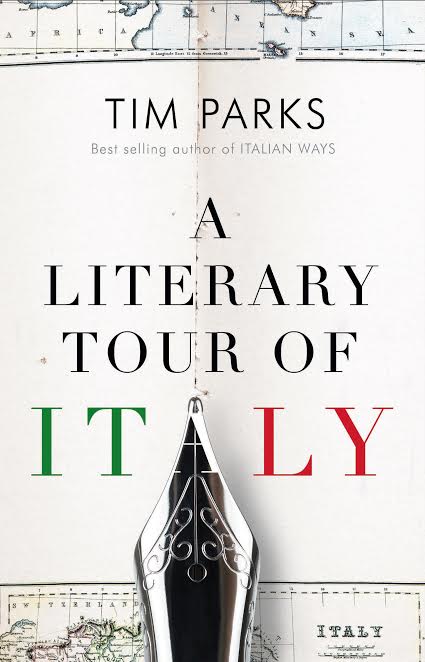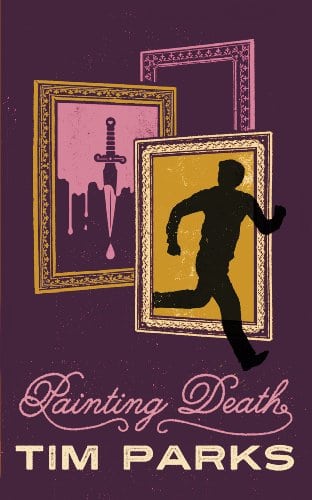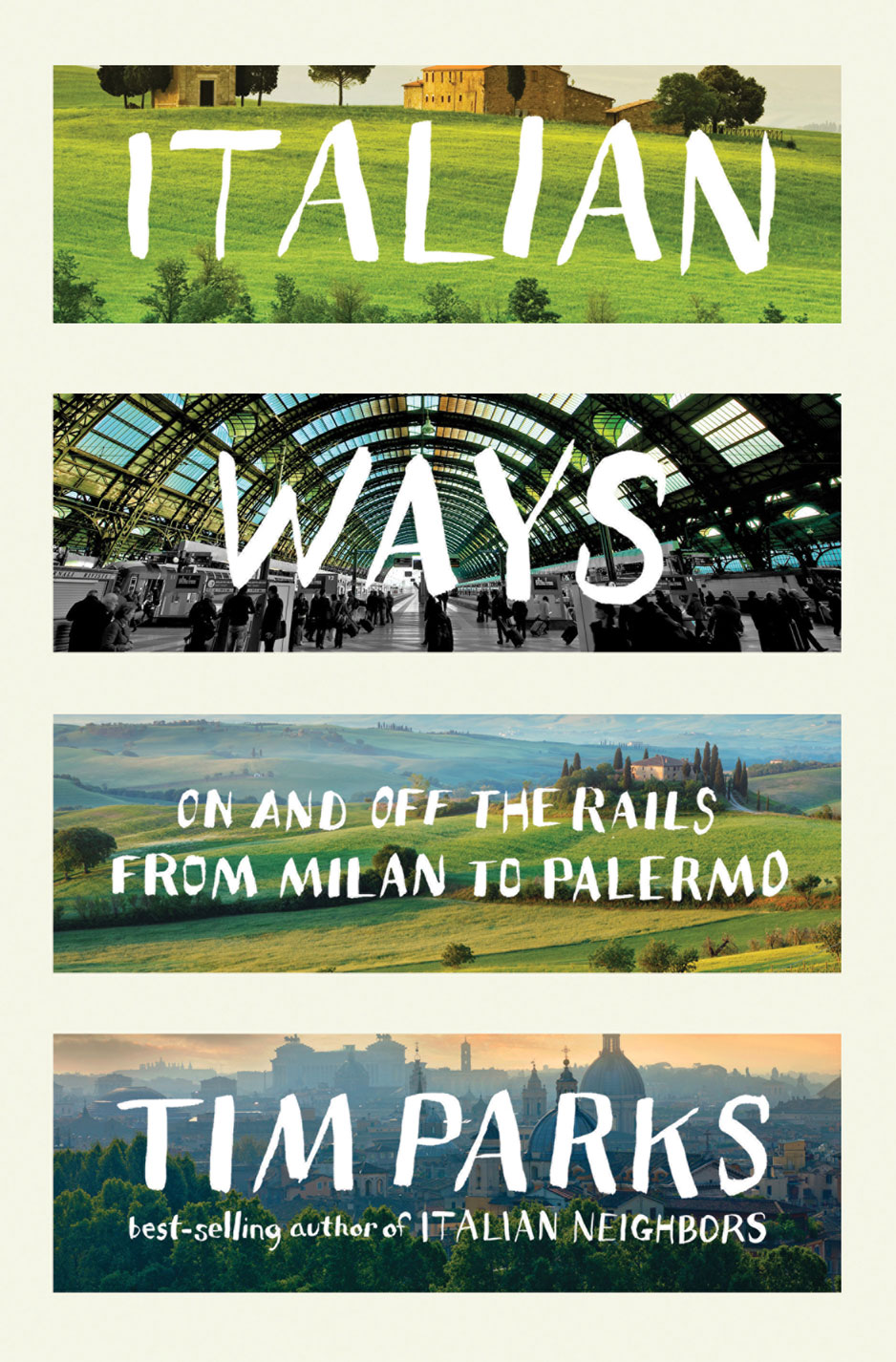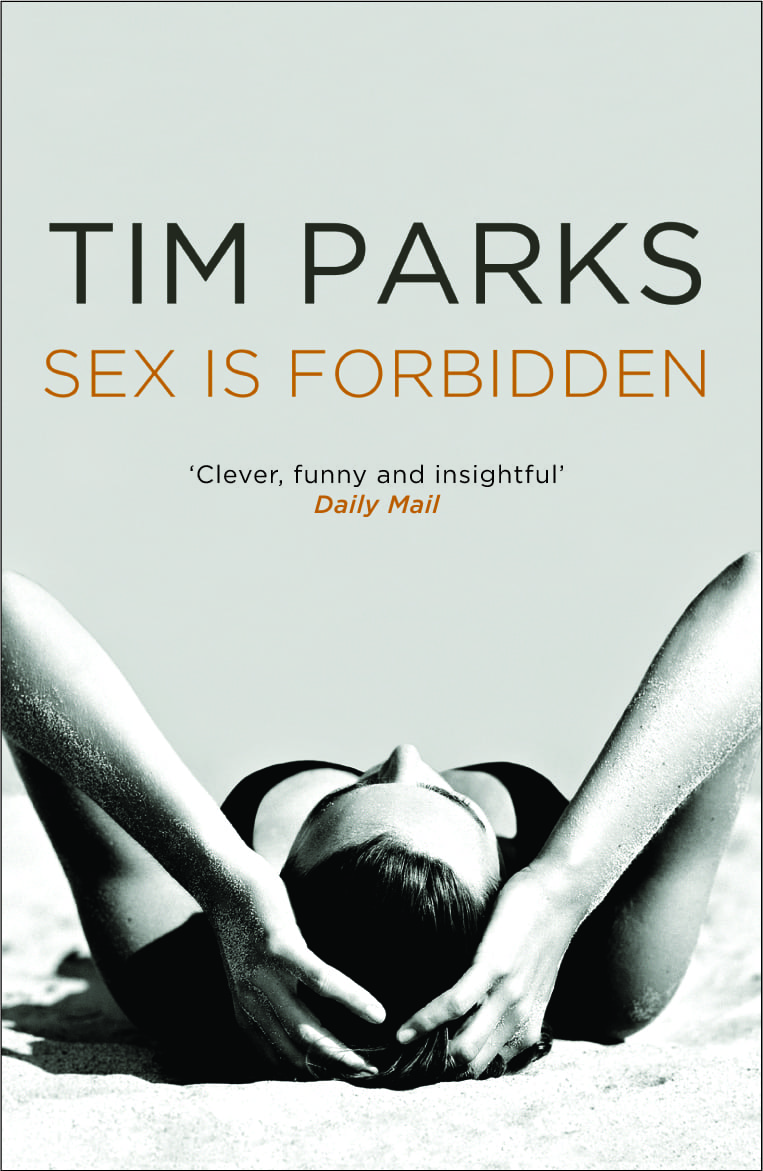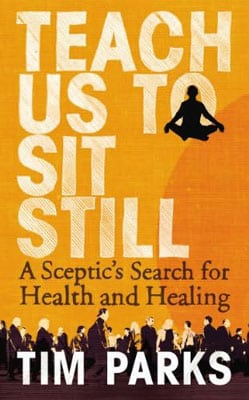Chronicart
Bernard Quiriny
Un roman saisissant (Destin) et un recueil de textes (Adultère et autres diversions) surprenants : deux nouvelles traductions de l’Anglais expatrié Tim Parks, romancier parmi les plus inclassables et singuliers de la dernière décennie.
Dans la nébuleuse littéraire britannique, pleine de petits compartiments, on est un peu en peine pour caser Tim Parks : voix détonnante, styliste inclassable, italien d’adoption (on y revient), auteur d’une dizaine de livres parmi lesquels les éditions Christian Bourgois ont déjà traduit un roman de 1997 (Europa), « one of the most gifted writers of his generation » (dixit l’enthousiaste Jonathan Yardley du Washington Post), l’insaisissable Parks est irréductible à un genre, une école, un courant -encore moins une mode. Avec Destin et Adultère et autres diversions (traduits de l’anglais par Jean Guiloineau, auquel on devait récemment le roman de l’Irlandais Michael Collins), on en découvre un peu plus d’une œuvre versatile, puissante, capable de gravité comme de légèreté, sinuant autour de la ligne de démarcation entre comédie et tragédie dans des textes étonnants et prenants. Né à Manchester en 1954, Tim Parks rencontra sa femme lors d’études à Harvard ; depuis 1981, ils habitent près de Vérone, dans le pays natal de celle-ci, où il enseigne, traduit et écrit. Son premier roman, Tongues of Flame, paraît en 1985 ; il publie depuis à un rythme quasi annuel des romans remarqués, souvent récompensés : Home thoughts (1987), Family planning (1989), Cara Massimina (sous le pseudonyme de John Mac Dowell, en 1990, repris par une série télévisée), Goodness (1991), Italian neighbours (énorme succès, ce texte de 1992 raconte l’intégration initiatique de l’auteur dans la vie sociale et culturelle italienne) suivi trois ans et deux romans plus tard par An Italian Education (sous-titré The Further adventures of an expatriate in Verona, il prolonge son portrait de la vie familiale en Italie -le Library Journal le compara aux célèbres bouffonades provençales de son compatriote Peter Mayle…). Traducteur de Moravia, Tabucchi, Tedeschi, Calasso ou Calvino, cet érudit éclectique est aussi l’auteur de quelques nouvelles et articles. Un parcours étonnamment riche, donc, dont on aurait tort de ne retenir que les étapes les plus légères : Destin est un roman difficile, saisissant, écrit avec une tension de plus en plus oppressante -une manière de crise.
A la première page, le narrateur, Christopher Burton, reçoit le coup de téléphone qui l’informe de la mort de son fils, Marco ; ce n’est que trois cents pages plus loin qu’il « pourra commencer à le pleurer », après une lutte épuisante contre des démons intérieurs et conjugaux qui repoussent toujours davantage le début de son deuil. C’est l’urgence, la tension de cette lutte que Tim Parks nous restitue ici. Sitôt après avoir appris cette mort, Burton, journaliste reconnu, écrivain ambitieux (son projet : « Une réalisation extraordinaire. Malgré l’échec de ton couple. Malgré le suicide de ton fils. Définir une fois pour toutes et de façon tout à fait irréfutable le problème de la prévisibilité du comportement humain »), décide de quitter sa femme italienne, à la fois cause et réceptacle principal de son mal-être, vers laquelle tendent tous les sentiments extrêmes qui se bousculent en lui. Elle l’obsède, l’excède et le passionne tout en même temps : « Ta mère a toute l’énergie, Marco. C’est la vérité. C’est pour cela qu’elle est tellement obscène, tellement scandaleuse, tellement séduisante. Elle m’attire et me repousse. » Marco, l’enfant chéri de ce couple violemment instable, obèse schizophrène et malade, en fut l’insupportable enjeu : « Non, laissez-moi vous dire ce que je pense pour une fois. C’était de notre faute et vous le saviez. Nous l’avons rendu fou. Nous avons fait qu’il lui a été impossible de vivre. Et vous le saviez. Nous l’avons emmuré. Aussi sûrement qu’avec des briques et du ciment. Vous le saviez. » Dans une prose dense, compacte, faite de phrases courtes et sèches, les impressions du narrateur se choquent, se heurtent et s’interpénètrent, restituant ainsi la dérive continue de ses pensées -son métier de journaliste, l’amant de sa femme, l’âme italienne (« Une sorte de dynamique italienne, si vous préférez. Une communauté complémentaire d’esprits »), L’Enfer de Dante, l’impossible douleur (« Il faut bien faire quelque chose pour tuer le temps. Même quand on va veiller son fils »), le patronage permanent de quelques grands noms de l’histoire des idées (Hobbes, Montesquieu)… Cette écriture serrée impressionne, étourdit et emporte : « Ce n’est pas tant du sommeil qu’une suite d’hallucinations dans lesquelles l’esprit lutte pour s’en sortir, simplement pour retomber dans la suivante. » Jusqu’à l’extrême fin, saisissante, ce lendemain où « nous pourrons commencer à pleurer notre fils ».
Dans les treize textes d’Adultères et autres diversions, Parks a voulu « mettre en scène la relation intime qui existe entre des réflexions éternelles et le cours ordinaire de nos vies ». Soit treize fables curieuses et très drôles, aux titres sentencieux (« Adultère », « Fidélité », « Gloire », « Fantômes », ainsi qu’un « Destin » où l’on pourra voir en filigrane une variante du roman), où l’écrivain met face à face les couples les plus antithétiques pour observer les chocs : « Tout à fait comme certains recherchent des stimulants sexuels bizarres quand ils arrivent à l’âge mûr, mon père découvrit les dons charismatiques de la première Lettre aux Corinthiens. » Ici, c’est un club de jeunes chrétiens qui « brûlait les disques d’un groupe qui s’appelait Black Sabbath et le soir allait à Soho manifester et chanter des cantiques devant des boîtes de strip-tease et des cinémas porno », là c’est un père qui exploite Stirner et Rousseau pour expliquer à son fils qu’il ne faut pas frapper son voisin de classe (« Vais-je vraiment expliquer la dialectique hégélienne à un enfant de onze ans ? ») -sous la houlette tutélaire, une fois encore, des grands noms de la philosophie politique (« J’ai refermé mon édition Penguin, et je me suis dit que personne n’avait compris aussi clairement que Platon que le monde était le lieu du changement et de la trahison »). Confrontations tragicomiques du grandiose et du prosaïque, ces nouvelles mettent au jour notre étrange va-et-vient entre les sommets et les profondeurs, chair et idées, sophia et phronesis. Voilà bien Tim Parks : « Chaque relation est un cosmos, ai-je pensé, chaque cosmos qui se respecte a son paradis et son enfer. »